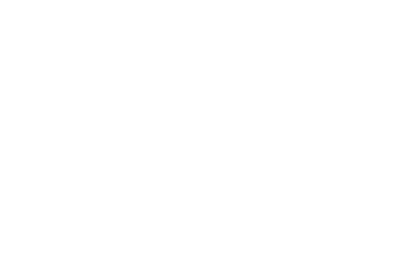Caractéristiques de l’installation
Intervenant(s)
Schindler
Installation
adaptation dans une cage d'escalier/un espace existant
Date de mise en service
1919
Statut juridique
Reconnaissance de la valeur historique le 22 décembre 2023
Ascenseur principal ou de service
ascenseur principal
Énergie
électrique
Numéro de série
4491
Nombre d'arrêts
5
Charge nominale (kg)
480
Nombre de personnes
6
Type de gaine
gaine fermée
Parois de la gaine
maçonnerie
Portes palières
élément(s) ancien(s)
bois
porte battante
Emplacement du contrepoids
en gaine commune
Boutons d'appel
anciens
La cabine
Forme de la cabine
quadrangulaire
Matériaux de la cabine
bois
Porte cabine
grille rétractile en bois et en métal
Boîte à boutons de commande
ancienne
Plaques signalétiques
anciennes
Anciennes marques de fabrique
oui
Machinerie
Emplacement de la machinerie
en toiture
Treuil
moteur ancien
Tableau de commande
ancien
Sélection d'étages
ancienne
Limiteur de vitesse
limiteur de vitesse ancien
Métadonnées
Date de rédaction de la fiche
Vendredi 22 décembre 2023
Auteur de la fiche
Muriel Muret
id
Urban : 411
Description
La Maison des Brasseurs est un immeuble reconstruit en 1698, après le Bombardement de Bruxelles, par la corporation des Brasseurs. Elle est profondément modifiée en 1919, pour la banque "Société générale de Belgique", avec l'ajout d'une extension derrière la façade arrière d'origine. En 1952, l'immeuble est encore transformé pour l'"Union des Brasseurs belges", qui y aménage un petit musée dans la cave.
L’ascenseur, de marque Schindler, se trouve contre le mitoyen gauche, derrière la cage d’escalier qui dessert le bâtiment, et qui date de 1919 comme la reconstruction des annexes latérales arrière.
L’ascenseur a été installé en 1919 en trémie fermée. Le moteurMoteur actionnant le treuil de l’ascenseur. était alors en cave, à côté de la trémie. Suite aux transformations des années 1950, l’ascenseur a été renouvelé en 1959/1960, en conservant mais adaptant la trémie. L’arrêt à l’entresol est condamné, la fosse de la trémie est approfondie et des arrêts sont créées pour desservir le niveau de cave où se trouve le nouveau Musée. Les accès y sont placés latéralement, avec des portes palières pleines sans doute de récupération (celles actuellement en place du moins). Les portes palières en chêne, numérotées aux étages, sont toujours celles de 1919, avec adaptation d’un panneau multiplex.
La vaste cabine en chêne, à placage en bandes verticales alternées, est typique de Schindler et date de 1959. Elle a la particularité d’avoir une double baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. d’accès (à l'avant et du côté latéral droit) pour desservir à la fois les arrêts des étages et des sous-sols. Les baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. sont fermées par des grilles rétractiles en bois et métal. Elle a conservé ses autres accessoires anciens (boutons de commande, marque de fabriqueGraphisme destiné à identifier une firme. Il peut prendre la forme d’une plaquette, d’un lettrage en relief..., fentes de ventilation en partie haute).
Un nouveau cabanon technique est créé sur le toit de l’annexe, avec nouvelle machinerieSitué dans un espace en partie basse ou en partie haute de l’installation, ensemble comprenant le système d’entraînement et les équipements de commande de l’ascenseur., globalement toujours dans son état de 1959.
L'ascenseur a donc été installé en 1919 puis renouvelé selon un permis de 1959, en conservant certains éléments (portes). Il est remarquable par son authenticitéL’authenticité d’un bien est évaluée au regard de la conformité de son état actuel par rapport à son état
d’origine. Un bien est considéré comme authentique si le plan, la forme, le concept, la fonction, les
techniques, les matériaux et la décoration des éléments intérieurs correspondent à un état significatif
(ou caractéristique). Même si un bien a subi une dégradation naturelle ou une transformation (par
exemple le remplacement des menuiseries, notamment des fenêtres, ou le remplacement des
devantures de magasin) il peut toujours être conforme à son état d’origine (la continuité structurelle est
préservée). Un bien est authentique si son concept et sa fonction initiale sont toujours lisibles (par
exemple un complexe industriel réaffecté).
La transformation peut alors être considérée comme un élément de son histoire. Il s’agit dès lors
d’évaluer l’éventuelle intégration d’éléments de valeur au cours de l’histoire du bâtiment., qui en fait un témoin très représentatif de la production de Schindler, ainsi que par son intégration qualitative dans ce bâtiment historique. Il présente un intérêt historiqueLe bien présente un intérêt historique :
- s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ;
- s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare
pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé
lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux
villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne,
la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ;
- s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple,
les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ;
- s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons
personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de
Constantin Meunier, la maison de Magritte) ;
- s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant
de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ;
- s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou
culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ;
- s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à
l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes
connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés
localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à
Berchem-Sainte-Agathe)., esthétique et technique.