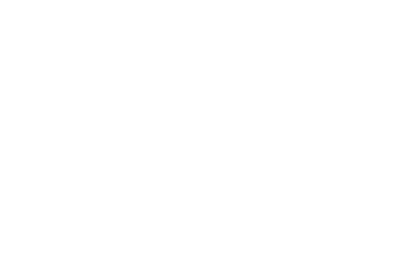Caractéristiques de l’installation
Intervenant(s)
Schindler
Otis
Abel Pifre
Installation
Date de mise en service
Statut juridique
Reconnaissance de la valeur historique le 22 juillet 2022
Ascenseur principal ou de service
Énergie
Nombre d'arrêts
Nombre de personnes
Type de gaine
Parois de la gaine
Portes palières
élément(s) ancien(s)
Guides
Emplacement du contrepoids
Boutons d'appel
Plaques signalétiques
Anciennes marques de fabrique
La cabine
Forme de la cabine
Matériaux de la cabine
Porte cabine
Boîte à boutons de commande
Plaques signalétiques
Anciennes marques de fabrique
Éclairage
Machinerie
Emplacement de la machinerie
Treuil
Tableau de commande
Sélection d'étages
Limiteur de vitesse
Métadonnées
Date de rédaction de la fiche
Auteur de la fiche
id
Description
Immeuble de commerce et de rapport construit sur des plans
de 1909 par l'entrepreneur Jean Craps, promoteur des immeubles de
l'avenue Lepoutre 65 et 69 dont le vestibule, la cage d’escalier et l’ascenseur
sont très semblables.
Un large vestibule, dont le sol est couvert de mosaïques à
motifs élaborés et aux murs entièrement revêtus de marbre, mène au hall qui
accueille l’escalier et l’imposant ascenseur de marque Abel Pifre-Otis. Intégré
soigneusement dès la construction du bâtiment, l'ascenseur circule en gaine
ouverte dans le jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. de l’escalier en bois. Les portes palières et le
garde-corps des paliers sont constitués de ferronneriesÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux. de style Beaux-ArtsStyle Beaux-Arts (de 1905 à 1930 environ). Courant architectural puisant son inspiration dans les grands styles français du XVIIIe siècle. Riche et ornementé, il se caractérise souvent par des élévations en (simili-)pierre blanche et/ou brique orangée ainsi que par l’usage du fer forgé pour les garde-corps et la porte. de
très grande qualité doublées d'un treillis à mailles losangées. Elles combinent
des motifs linéaires, végétaux et à volutesOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. sous une arcadeBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. surmontée d'un
cartouche qui indiquait le numéro de l'étage, aujourd’hui masqué sous la peinture.
La rampe de l’escalier en bois est surmontée d'un haut cadre équipé d’un treillis à
mailles losangées enserré dans des frisesBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. de ferronneriesÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux. décoratives.
La cabine en bois d’acajou a fait l'objet d'un travail d’ébénisterie
remarquable. A panneautages, elle est spacieuse et équipée de glaces biseautées
dans sa moitié supérieure. Son toit bombé et ajouré était probablement muni de
vitraux à l'origine, à l'instar de l’ascenseur du numéro 65 de la même avenue. Les montants
d’angle du toit, très abîmés, accueillent actuellement une tôle perforée et le
sommet du toit est pourvu d’un treillis. L’installation a fait l’objet de
transformations par l’entreprise Schindler, probablement dans les années 1930 :
remplacement des portes de cabine coulissantes en bois d’origine par une grille
rétractile en métal, des boutons d’appel et d’une grande partie de la
machinerie (dont le moteurMoteur actionnant le treuil de l’ascenseur., le freinDispositif placé sur l’axe du moteur qui le freine et le
maintient à l’arrêt grâce à deux mâchoires se fermant sur un tambour. Par
défaut, le frein est en position fermée. Son ouverture est déclenchée par
l’intermédiaire d’une bobine ou d’un servomoteur. et son moteur). L’accès au dernier étage a
été condamné. Par la
suite, la cabine a été équipée par
Otis d’un nouveau boîtier à boutons de commandeSérie de boutons placés en cabine qui permettent de sélectionner automatiquement l’étage souhaité. Un bouton d’arrêt, un bouton d’alarme et un interrupteur pour l’éclairage complètent souvent ce dispositif. et les portes palières, de serrures positives électriques. Un nouveau
tableau de commande intègre la sélection d’étage.
Les poulies
de déflexion, en cave, et de renvoi des câbles de la cabine et du contrepoidsRelié à la cabine par les câbles de traction et circulant le long de guides verticaux, il est généralement constitué d’éléments en fonte (gueuses). Son poids équivaut à celui de la cabine à demi-charge. Il contrebalance ainsi le poids de la cabine ce qui diminue l’énergie nécessaire à son déplacement., dans les comblesEspace intérieur de la toiture., sont d’origine. Le système de freinDispositif placé sur l’axe du moteur qui le freine et le
maintient à l’arrêt grâce à deux mâchoires se fermant sur un tambour. Par
défaut, le frein est en position fermée. Son ouverture est déclenchée par
l’intermédiaire d’une bobine ou d’un servomoteur. parachuteSystème de sécurité qui bloque la cabine sur ses guides en cas de rupture des câbles de traction ou de survitesse. , à ressort, est
un exemple rareLa rareté d’un bien est déterminée à la fois sur le plan qualitatif (le caractère « exceptionnel ») et le
plan quantitatif (le caractère unique), en fonction du contexte géographique (local, régional, national),
chronologique et historique (la production globale dominante de l’époque : concept, style, matériaux,
etc.) ou par rapport à l’ensemble de la production du concepteur, et ce, tant d’un point de vue formel
que fonctionnel et constructif. Pour évaluer la rareté d’un bien, il convient de le comparer à d’autres
biens appartenant à la même catégorie (typologie, chronologie-âge [datation]/période ou partie de cette
période, aspect esthétique et/ou technique, fonction, impact social ou historique). et intéressant que l'on retrouve dans les
autres installations d'Abel Pifre-Otis datant d'avant-guerre (avenue Volders 39 et 2, place Brugmann 6). En l'absence d'étrier supérieur, les coulisseaux
de guidage sont fixés directement sur la cabine. Un bouton d’appel d’origine
est conservé au dernier étage. Les câbles et le contrepoidsRelié à la cabine par les câbles de traction et circulant le long de guides verticaux, il est généralement constitué d’éléments en fonte (gueuses). Son poids équivaut à celui de la cabine à demi-charge. Il contrebalance ainsi le poids de la cabine ce qui diminue l’énergie nécessaire à son déplacement. sont
dissimulés dans deux gaines aménagées dans les angles de la cage d’escalier. La
cuvette de l'ascenseur, visible depuis le rez-de-chaussée, a fait l'objet d'un
traitement décoratif en carrelages colorés.
Cet ascenseur encore très authentique, rareLa rareté d’un bien est déterminée à la fois sur le plan qualitatif (le caractère « exceptionnel ») et le
plan quantitatif (le caractère unique), en fonction du contexte géographique (local, régional, national),
chronologique et historique (la production globale dominante de l’époque : concept, style, matériaux,
etc.) ou par rapport à l’ensemble de la production du concepteur, et ce, tant d’un point de vue formel
que fonctionnel et constructif. Pour évaluer la rareté d’un bien, il convient de le comparer à d’autres
biens appartenant à la même catégorie (typologie, chronologie-âge [datation]/période ou partie de cette
période, aspect esthétique et/ou technique, fonction, impact social ou historique). témoin d’une
installation d’avant-guerre par Abel Pifre-Otis, présente un
très grand intérêt esthétiqueHistoriquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones
naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands
ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments
qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique,
l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et
l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants
lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle., historique et technique.