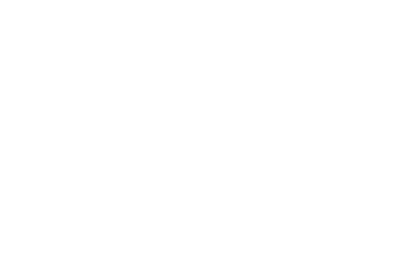Caractéristiques de l’installation
Intervenant(s)
Thirionet L.
Stigler
Ateliers Moës Liège, moteur
Installation
Date de mise en service
Statut juridique
Reconnaissance de la valeur historique le 29 août 2022
Ascenseur principal ou de service
Énergie
Numéro de série
Nombre d'arrêts
Charge nominale (kg)
Nombre de personnes
Type de gaine
Parois de la gaine
Portes palières
élément(s) ancien(s)
Guides
Emplacement du contrepoids
Boutons d'appel
Plaques signalétiques
Anciennes marques de fabrique
La cabine
Forme de la cabine
Matériaux de la cabine
Porte cabine
Boîte à boutons de commande
Plaques signalétiques
Anciennes marques de fabrique
Éclairage
Accessoires de la cabine
Machinerie
Emplacement de la machinerie
Treuil
Tableau de commande
Sélection d'étages
Limiteur de vitesse
Métadonnées
Date de rédaction de la fiche
Auteur de la fiche
id
Description
Immeuble à appartements
de style Beaux-ArtsStyle Beaux-Arts (de 1905 à 1930 environ). Courant architectural puisant son inspiration dans les grands styles français du XVIIIe siècle. Riche et ornementé, il se caractérise souvent par des élévations en (simili-)pierre blanche et/ou brique orangée ainsi que par l’usage du fer forgé pour les garde-corps et la porte. construit vers 1932. Ses deux façades, avenues Prekelinden
et du Castel, s’articulent à l’angle par une rotonde. Il forme un ensemble avec celui, identique, situé sur l'angle d'en face.
Prévu dès l’origine, l’ascenseur est dû à l’installateur
bruxellois Thirionet et est probablement de la marque italienne Stigler que Thirionet installait à Bruxelles à cette époque. Il est positionné dans l’axe de l’entrée, au centre de
l’escalier en marbre, et circule en gaineEspace dans lequel se déplacent la cabine et/ou le contrepoids, délimité par les parois, le plafond et le fond de la cuvette. La gaine peut être fermée ou partiellement ouverte. en partie ouverte. La protection de celle-ci est
assurée par un garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... constitué de panneaux en bois surmontés de cadres
également en bois enserrant un treillis métallique à mailles carrées. Les portes palières
battantes en bois sont encadrées latéralement de panneaux en bois plein sur toute leur
hauteur. Celle du rez-de-chaussée est aussi surmontée d’un panneau de bois en imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie.. Toutes identiques, les portes palières battantes présentent un large jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. à petits-bois, terminé en forme de chapeau de gendarme et protégé
par un treillis métallique.
La cabine, panoramique, en bois panneauté est similaire à d'autres cabines de la marque Stigler. Elle a conservé quelques-unes de ses dispositions anciennes : six vitres oblongues, grille rétractileSystème de fermeture, constitué de montants réunis par des croisillons mobiles, qui se replie et se déplie sur lui-même entre un rail supérieur et un rail inférieur. en bois et métal, plaques signalétiques, lettrage doré qui indiquait initialement la charge maximale.
Située dans la cave, la machinerieSitué dans un espace en partie basse ou en partie haute de l’installation, ensemble comprenant le système d’entraînement et les équipements de commande de l’ascenseur. est encore constituée d’éléments anciens : moteurMoteur actionnant le treuil de l’ascenseur. des ateliers Moës à Liège et sa bobine
de freinDispositif placé sur l’axe du moteur qui le freine et le
maintient à l’arrêt grâce à deux mâchoires se fermant sur un tambour. Par
défaut, le frein est en position fermée. Son ouverture est déclenchée par
l’intermédiaire d’une bobine ou d’un servomoteur. , probablement placés lors du passage du courant continuUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées. vers le
courant alternatif , poulieRoue dont la jante porte un ou plusieurs câbles afin de permettre la transmission d’un mouvement. Fixée sur l’axe du treuil, la poulie de traction (ou poulie d’adhérence) communique la force du moteur aux câbles de traction de la cabine et du contrepoids. La poulie de déflexion permet de déporter les câbles dans l’axe de la gaine de l’ascenseur et/ou du contrepoids. Les poulies de renvoi situées au-dessus de la gaine supportent les câbles de traction quand la machinerie est placée en bas. de traction. Le bâti du treuilAccouplé au moteur, dispositif mécanique qui entraîne les câbles de la cabine et du contrepoids sur un tambour ou une poulie d’adhérence. et le bas du frein
semblent être de la marque Stigler. Les poulies de renvoi
de la cabine et du contrepoidsRelié à la cabine par les câbles de traction et circulant le long de guides verticaux, il est généralement constitué d’éléments en fonte (gueuses). Son poids équivaut à celui de la cabine à demi-charge. Il contrebalance ainsi le poids de la cabine ce qui diminue l’énergie nécessaire à son déplacement., qui circule en façade arrière, ainsi que le
limiteur de vitesse, situés en toiture, sont également conservés.
Intégré avec soin dans son environnement architectural, cet
ascenseur encore en grande partie authentique présente un intérêt esthétiqueHistoriquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones
naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands
ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments
qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique,
l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et
l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants
lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle. en
plus de son intérêt historiqueLe bien présente un intérêt historique :
- s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ;
- s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare
pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé
lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux
villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne,
la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ;
- s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple,
les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ;
- s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons
personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de
Constantin Meunier, la maison de Magritte) ;
- s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant
de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ;
- s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou
culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ;
- s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à
l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes
connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés
localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à
Berchem-Sainte-Agathe). et technique.